Les Enfants du Paradis : épisode 2
Lundi 11 juillet 2011. Les Enfants du Paradis de José Martinez, par le Ballet de l’Opéra de Paris à l’Opéra Bastille. Avec Eve Grinsztajn (Garance), Bruno Bouché (Baptiste), Karl Paquette (Frédérick Lemaître), Stéphane Phavorin (Lacenaire), Mélanie Hurel (Nathalie), Aurélien Houette (Le Comte), Caroline Robert (Madame Hermine), Aurélia Bellet (la Ballerine) et Nolwenn Daniel (Desdémone).

Oui, l’épisode 2 arrive après l’épisode 3. Les adieux de José Martinez méritaient bien la priorité.
Cette représentation ne fut pas la meilleure de la série, mais resta intéressante pour mieux se rendre compte des faiblesses, mais aussi des qualités de ce ballet. Elle le fut d’autant plus que les deux rôles principaux font partie des mauvaises nouvelles.
Eve Grinsztajn, peu distribuée dans un rôle principal, était très attendu. Malheureusement, elle n’a pas su guider sa Garance de façon intelligente dans la dramaturgie. L’interprète ne savait en fait sur quel pied danser : la jouer tragédienne façon Isabelle Ciaravola ? Ou plus enjôleuse comme Agnès Letestu ? Eve Grinsztajn n’a pas su trancher, et son personnage en a souffert, manquant singulièrement de caractérisation. Ce qui n’enlève rien à l’élégance de la danseuse, ni à son indéniable présence en scène. Ce qui rend ce raté d’autant plus désappointant.
Bruno Bouché a pour sa part voulu se démarquer de Stéphane Bullion et Mathieu Ganio, interprètes à la forte personnalité. Contrairement à ses collègues, le danseur a choisi de donner à Baptiste un côté très terre-à-terre. Voir très (trop) romantique dans le deuxième acte, jouant à fond l’amant désespéré. Un parti-pris qui aurait pu être intéressant s’il n’avait enlevé toute la poésie du personnage. Baptiste est un Pierrot dans la lune, qui n’a pas les pieds sur terre. Et Bruno Bouché les avait bien trop ancrés dans le sol pour que l’on puisse tomber sous le charme.

Comme c’est souvent le cas dans ce genre de distributions, les seconds rôles ont brillé. Karl Paquette en tête. Il paraît que les danseurs sont fatigués en fin de saison. Faux pour ce dernier, qui a sauté et virevolté bien plus haut qu’il y a six mois. Le danseur se plait visiblement en Frédérick Lemaître, à la fois jeune premier brillant, petit malin sans trop de scrupule et papillonneur expert. Un brin plus canaille et cynique que Florian Magnenet, ce qui est une très bonne idée.
Stéphane Phavorin fut également un bon moment en Lacenaire, ce qui n’est pas vraiment une surprise. Ce danseur est un habitué de ces deuxièmes rôles roublards. Il l’a joué élégant dandy, avec cette pointe de second degré très appréciable. Décidément, nous sommes dans un conte, sur scène, là où tout peut se passer, et certainement pas dans la vraie vie. Ne nous prenons pas trop au sérieux. J’aime beaucoup cette espèce de distance qu’il instaure, tout en rendant très crédible son personnage. L’interprète se différencie ainsi toujours des autres, et cela le rend plutôt attachant.
Plus généralement, trois gros défauts ressortent des Enfants du Paradis.
Tout d’abord, les scènes de foule. Et plus particulièrement la scène d’ouverture. Trop de choses se passent, l’œil ne sait pas où se poser, et rate forcément des détails. Il y a ainsi trois scènes qui se déroulent en même temps : les trois filles sur scène, la bande d’acrobates, et l’arrivée de Garance. Les trois sont intéressantes, les deux premières pour l’ambiance, la dernière pour la dramaturgie. Mais les placer en même temps les auto-neutralise complètement.

Ensuite, les passages parlés. Déjà, problème, la danse, ça ne parle pas. D’où sa force d’ailleurs, arriver à faire passer tant de chose uniquement avec le corps. Etait-ce pour le rapprochement avec le film ? La peur de José Martinez de ne pas être compris ? L’utilité de la parole reste pour moi un mystère, voir une véritable gêne.
Ce premier faux pas arrive lors de la première pantomime, et le public qui se met à hurler son mécontentement. Aucun intérêt, la chorégraphie se suffit très bien à elle-même. Deuxième, et beaucoup plus pénible, le cri de douleur du Comte, lors du deuxième acte. Qui a plus fait rire mes voisin-e-s qu’autre chose. La mise en scène est là encore suffisamment dramatique sans avoir besoin de cordes vocales, les danseurs choisis étant en plus de très bons comédiens. A enlever impérativement lors de la prochaine reprise.
Enfin, et je sens que je vais me faire lyncher, l’Othello de l’entracte est de trop. Bien sûr, en soi, c’est très sympathique de voir les danseur-se-s évoluer d’aussi près et dans un cadre différent. Mais ensuite ? La partie en elle-même reste assez creuse, que ce soit niveau chorégraphique ou musicale. Et si j’ai apprécié ces moments, c’est plus de regarder les gens amassés jusqu’au troisième loge, et de découvrir cette nouvelle “scène” à laquelle on n’avait pas pensé, alors que l’on connaît bien cet escalier.
José Martinez a voulu se faire plaisir en utilisant tous les coins du Palais Garnier, mais il en a fait trop. Et comme pour les larmes ou les sucreries, la théorie reste la même : trop de théâtre dans le théâtre tue le théâtre dans le théâtre. Il y a déjà les pantomimes, ou le public devient “figurant”, comme l’expliquait le chorégraphe lors d’une rencontre. La partie Robert Macaire joue également très bien son rôle, et reste en plus un divertissement plutôt sympathique.

Mais où se situe exactement Othello ? Une pièce dans la pièce de la pièce ? Les spectateur-ice-s autour de moi semblaient plutôt désorienté-e-s, certain-e-s croyant même qu’il s’agissait d’une pub pour l’opéra éponyme donné à Bastille. Idem pour la répétition des ballerines. On ne sait pas bien s’il s’agit d’un fait exprès, et où se trouve le lien avec ce qui suit. Un rideau qui se lève sur un beau tableau Robert Macaire aurait été, je pense, plus percutant.
Ces rajouts sont d’autant plus dommages que les parties théâtre dans le théâtre, à savoir les passages de pantomime, restent pour moi les meilleurs moments du ballet. Il est difficile de ne pas résister à ces petites histoires, à la fois désuètes et si remplie de poésie. La partition leur a en plus réservé ses plus beaux moments. Je rajoute également les deux scènes dans la chambre de Madame Hermine, très efficace au niveau de la mise en scène, et véritablement émouvante.
Etrange tout de même de conclure que, pour un ballet, les plus beaux passages sont les parties non-dansées.
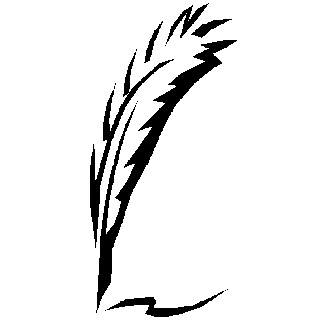


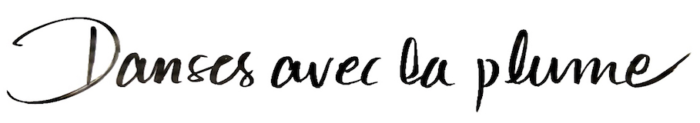
elendae
Je suis d’accord avec toi sur le cri du comte, ça n’apporte rien. Par contre je peux voir un intérêt à laisser les danseurs huer ou applaudir bruyamment par mimétisme avec la salle. C’est intéressant d’ailleurs de voir les réactions du public, certains soirs il comprend que cela fait partie de la pièce et demeure alors spectateur, d’autres se mettent alors spontanément à applaudir en même temps, par réflexe ou par enthousiasme !
J’ai remarqué sinon que, du haut de mon amphithéâtre, je n’avais absolument pas vu la mort du comte. Etant donné que c’est quand même un élément important de l’histoire, c’est dommage.
J’aime bien les scènes de pantomime également, mais j’adore aussi la scène en miroir des chambres, et puis la scène finale, quand même, qui a du chien. Bravo José !!
Anne-Laure
Je suis tout à fait d’accord avec toi sur l’ajout des voix. Cela ressemble alors davantage à des passages de comédie musicale que de danse. La danse c’est l’implicite des corps… Pour l’entracte, la scène d’Othello était belle et c’était vraiment bien de voir les danseurs évoluer de si près. Par contre, le rapport avec la pièce est plus que ténu…
Amélie
@ Elendae : Parce que le Comte meurt ? Et bien du parterre je ne l’avais pas vu non plus… Je te rejoins pour la scène finale, vraiment très efficace et touchante.
Cams
Oui le comte meurt!! il se fait tuer par Lacenaire!
Je me rappelle la première fois que j’ai vu le ballet je me suis dis “mais c’est drôle il me semblait que dans le film il mourrait!”.
En fait la scène a lieu derrière un rideau pendant le pas de deux de Baptiste et Garance dans la chambre donc forcément notre attention est ailleurs. Mais même du parterre et en cherchant bien je trouve que c’est très difficile à voir!!
Pour la scène d’Othello je trouve qu’elle perd de la force à force de la voir. Je me rappelle qu’à la création j’avais vraiment adoré. C’était tellement original de voir les danseurs dans le grand escalier et tous ces gens autour en train de les regarder.
Puis cette année, en l’ayant vu 5 ou 6 fois cela commence à lasser…
elendae
Eh oui en fait moi j’y ai fait attention lors de la répétition sans les décors. Là, il n’y avait pas de rideau ou de morceau de décor pour cacher ce qui se passait, et on voyait clairement Larcenaire tuer le Comte.
Ce qui rend moins compréhensible, du coup, que ce soit lui (si je ne me trompe pas, c’est ce que j’ai vu de mon amphithéâtre le 15…) qui porte Garance hors de la scène, vu qu’il est mort !!!
Y a visiblement encore des petites modifications à apporter à ce ballet quand même 😆