
Soirée Lander/Forsythe – Début de bilan
C’est l’expression de la rentrée : la soirée Lander/Forsythe du Ballet de l’Opéra de Paris, qui marque le début de sa saison, est un bon bilan de ce qu’est la compagnie aujourd’hui. Le programme est en effet ambitieux, reflétant à la fois la technique classique dans sa plus pure virtuosité et l’ouverture à une formidable contemporanéité. Verdict ? La troupe sait admirablement bien jouer sur les deux tableaux, de façon assez bluffante. Mais uniquement en restant groupé. Émerger en tant que soliste fut bien plus compliqué.
Études n’a pas été choisi au hasard par Brigitte Lefèvre pour son dernier programme. Harald Lander, le chorégraphe de la pièce, a été son directeur à l’École de Danse. Ce ballet est un petit bijou de virtuosité à la technique académique imparable. Des dégagés à la barre aux grandes variations, en passant par le grand écart et les exercices de pirouettes, ce ballet est un peu le résumé d’une classe de danse. C’est aussi le symbole du parcours de la ballerine, du grand plié (pas de base) fait en regardant fièrement le public, telle une petite fille faisant ses premiers pas sur scène, à l’apothéose d’une Étoile en pleine possession de ses moyens techniques. Virtuosité pure ? Pas seulement. Études se savoure aussi par sa progression, sa montée en puissance, et cet humour sous-jacent qui peut rendre le tout si irrésistible.
Le corps de ballet féminin assure joyeusement sa partie, quand aucune erreur ne pardonne. Imaginez un peu, douze danseuses alignées, la lumière uniquement sur leurs pieds, à enchaîner à toute vitesse dégagés, fondus et grands battements dans un ensemble parfait. Puis la classe se fait plus grande, les barres s’en vont. Les exercices s’enchaînent et deviennent de plus en plus diaboliques, quand les danseuses, petit sourire en coin, semblent dire au public : “Pfff, tout ça est tellement simple, nous pouvons faire bien plus compliqué !“. Le corps de ballet masculin, pas en reste, régale de ses sauts parfaitement réglés et d’une magnifique diagonale de grands jetés finals.
Tout était donc bien parti, mais il a manqué pour une vraie réussite un trio de solistes au diapason. La distribution du soir avait de quoi être alléchante : Amandine Albisson, Arthur Raveau (Pierre-Arthur Raveau a raccourci son prénom pendant les vacances) et François Alu. Un trio plein de qualités, certes, mais encore un peu vert et qui ne semblait pas toujours s’entendre.
Amandine Albisson a fait une arrivée pleine de panache. La jeune Étoile sait occuper la scène et s’imposer. Moins à jouer sur la corde de la poésie. Pour sa version française, Harald Lander a en effet rajouté un petit passage tout ce qu’il y a de plus romantique, une évocation de La Sylphide. Plus de technique pur, mais une ambiance de théâtre. À ce jeu-là, la ballerine a plus de mal, très préoccupé aussi par son pas de deux avec Arthur Raveau qui ne semblait pas complètement réglé. Amandine Albisson, en général reconnue pour ses qualités de technicienne, a pourtant eu du mal à aller au bout du parcours, ratant malencontreusement ses fouettés lors de sa variation. Bien sûr, il serait injuste de juger une danseuse sur des fouettés ratés, ce qui peut arriver à n’importe qui (certain-e-s diront que ça n’a jamais dû arriver à Tamara Rojo, mais vous voyez ce que je veux dire). N’empêche que ces fouettés, c’est le point culminant d’une variation qui est le point culminant d’un rôle. Pour la montée en puissance, on repassera donc.
Le duo masculin a aussi cherché ses marques. Études est construit pour mettre en opposition les deux solistes masculins, rivalisant chacun de virtuosité tout en se disputant les honneurs de la ballerine. Mais mis à part un regard au début, les deux danseurs se sont plus ignorés. Arthur Raveau a tout pour briller dans ce répertoire, avec sa danse romantique, si “école française”, la précision et la musicalité de sa petite batterie. Le danseur semblait pourtant crispé (et vu de près, ça ne pardonne pas), appréhendant toutes les difficultés. Et ses sourires à la fin des pirouettes ressemblaient plus à des “ouf” de soulagement qu’à une grande assurance.
François Alu fut le seul à ne pas avoir eu peur de faire le spectacle. Comment ne pas avoir ce petit frisson quand il bondit dans la Mazurka, droit dans les yeux du public annonçant bien la couleur ? Il bondit comme de rien et tourne semblant ne jamais devoir s’arrêter. Mais tombe presque dans le sur-effet. Comme s’il n’arrivait pas complètement à canaliser sa formidable énergie, ses sauts sont un peu trop bruts de décoffrage et manquent de cet infime polissage, qui, à la hauteur fabuleuse de ses pas, rajoute cette touche d’élégance. Dommage donc pour ce trio qui s’annonçait si prometteur. Études a ainsi du mal à dépasser le statut de simple démonstration, sauvé par les ensembles au charme décidément enthousiasmant.
Après l’entracte, saut dans le temps pour retrouver William Forsythe. La technique classique y est encore la base. Mais étirée au maximum, malaxée, déséquilibrée. Woundwork 1 est un jeu de spirales, où les dos et les bassins se courbent en d’incessantes voluptes. Marie-Agnès Gillot, revenue après un an d’absence, y montre toute son extraordinaire science du mouvement, ce quelque chose de captivant qui rend toute abstraction fascinante. Hervé Moreau est sur la même longueur d’onde, interprète qui prend possession de la scène avec tant de personnalité. Woundwork 1 est censé être un quatuor, deux couples se partageant la scène sans jamais se croiser. Mais face à l’entente Gillot/Moreau, le deuxième couple sembla comme resté dans l’ombre.
Pas./Parts, toujours de William Forsythe, joue plutôt sur les déséquilibres. Cet instant d’aller un peu trop sur sa pointe, de se déhancher un peu trop en pleine vitesse, à la limite de tomber, mais de se rattraper à la dernière minute par une ultime rotation ou mouvement du bassin. Aller chercher constamment cette limite a quelque chose de jubilatoire à regarder. Mais la distribution du soir se montra un peu trop frileuse. Audric Bezard s’imposa comme le patron du groupe, impressionnant de maîtrise et de ce sens du déséquilibre. Hannah O’Neill ou Émilie Hasboun se montrèrent aussi particulièrement à l’aise dans cette énergie électrique. Les autres restèrent dans une demi-mesure, comme bloqué-e-s par la peur de mal faire. Un peu de prise de risque, voilà aussi ce qu’il manque s’il faut résumer le bilan le santé.
Soirée Lander/Forsythe par le Ballet de l’Opéra de Paris, au Palais Garnier. Études de Harald Lander, avec Amandine Albisson, François Alu et Arthur Raveau. Woundwork 1 de William Forsythe avec Marie-Agnès Gillot, Hervé Moreau, Alice Renavand et Florian Magnenet. Pas./Parts de William Forsythe, avec Hannah O’Neil, Stéphanie Romberg, Audric Bezard, Muriel Zusperreguy, Fabien Révillion, Alexandre Gasse, Aubane Philbert, Ninon Raux, Alessio Carbone, Maxime Thomas, Valentine Colasante, Ida Viikinkoski, Yann Saïz, Émilie Hasboun et Pauline Verdusen. Jeudi 25 septembre 2014.
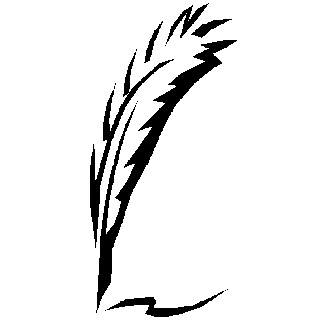


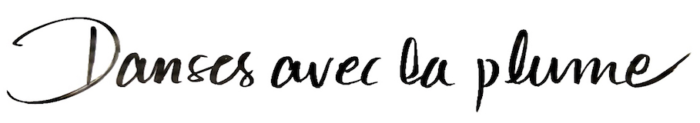




Adèle
Moi, j’ai vu la distribution Paquette/Gilbert/Hoffalt lors de la première, et on sentait qu’ils n’étaient pas très à l’aise. Et pour cause, le chef d ‘orchestre ne les a pas vraiment aidés. Les tempi étaient un peu en accordéon… Eh oui, voyez-vous dans un spectacle, il y a la danse certes, mais la musique aussi qui joue un rôle prépondérant, car, dans notre cas, cela mettait les danseurs dans un état de stress qui n’est pas confortable.
a.
je ne sais si c’est moi, mais je trouve que le passage sylphide casse le rythme – mais j’ai toujours eu un pb avec les tutus longs (vengeance perso?). J’ai vu Gilbert/Hoffalt/Paquette donc pas vu A. Albisson, mais très étonnée qu’elle ait raté la passage sylphide au vu de sa “vraie” Syplhide qui m’avait charmée il y qq années. Mais c’est vrai que de ballet est avant tout le ballet du corps du ballet… <3
a.
ah! j’ajoute encore que Laura Hecquet fut de toute beauté!
Danute
Il y a une chose que je ne comprend pas , c’est pourquoi dit-on que A.Albisson est une technicienne? On prend cela souvent comme une “excuse” pour pallier à son manque d’aura, de charisme . Or , je n’ai jamais vu cette danseuse faire plus de deux pirouettes, ou sauter particulièrement haut, enfin pour moi une technicienne est une danseuse comme Marianela Nunez, Natalia Osipova…. cela en dit beaucoup sur l’Opéra de Paris si une danseuse qui juste “réussit” à faire les pas imposés est considérée comme une technicienne. Surtout que ses fouettés on effectivement été raté, cela peut arriver mais le reste de la représentation n’était du niveau d’une “technicienne”. Je n’ai rien contre cette danseuse seulement le public français devrait ouvrir un peu les yeux.
soloazad
Je pense que si l’on parle de technique et d’aura sur scène, c’est bien à Valentine Colasante qu’il faut penser.
Souvent dans des rôles de second plan, elle est néanmoins une valeur sûre de disponibilité et de régularité de nos premières danseuses.
Rêvons que nous la retrouvions régulièrement sur scène.
Cordialement à tous
zane
Les fouettés ratés de la demoiselle ne sont rien à côté du vide artistique qu’elle exprime en dansant, c’est pathétique mais je crois qu’il faut arrêter de l’excuser pour tout ce qu’elle fait qui n’est jamais le bon jour ou le bon ballet ou le bon partenaire, même si elle est quelque part victime du pouvoir qui l’a mise en place coute que coute Aujourd’hui l’addition est là
nic
Je ne sais pas qui a fait les distributions de la rentrée mais il a fallu attendre que ce soit un Sujet qui arrive à exécuter les difficultés de la chorégraphie de Länder qui sont un des seuls intérêts du ballet Aucune Etoile ne s’est frottée aux sautés sur pointes pendant les fouettés, ni n’à essayer d’apporter un peu d’âme à son personnage, c’est dire le niveau Chapeau à Mademoiselle Bourdon qui a été magistrale de bout en bout dans cette prise de rôle difficile et a réussi à élever la soirée très haut Elle a mérité l’ovation que le public lui a réservé à la fin du spectacle
Amélie
@ Adèle : Plusieurs commentaires faisaient en effet état d’un tempo assez aléatoire lors de la première (et de quelques fausses notes…). Pour cette représentation précise, la musique n’a pas semblé posé trop de problème (du moins à l’oreille).
@ a. : Son problème semblait surtout venir du partenariat qui ne semblait pas encore bien rôdé… Mais ce passage Sylphide rajoute une difficulté supplémentaire, de partir sur complètement autre chose. Je rejoins pour Laura Hecquet ;).
@ Danute : Études est assez criant sur les manques de l’ONP en ce moment… J’ai toutefois vu Amandine Albisson en meilleure forme.
@ Zane : Merci de modérer vos propos, pas d’acharnement.
@ Nic : Impossible de voir Héloïse Bourdon, mais je le regrette, les commentaires sur sa prestation sont en effet sous le charme !