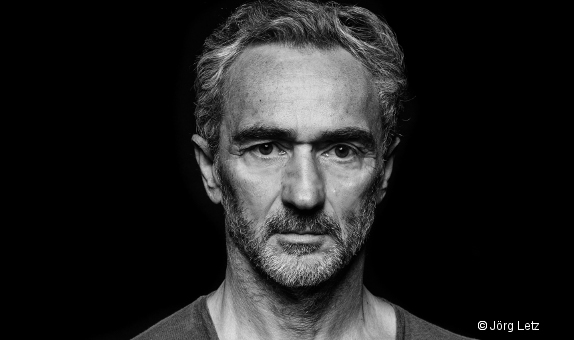
Angelin Preljocaj : “Chaque interprétation ajoute une couche à ce millefeuilles mystérieux qu’est une oeuvre”
Angelin Preljocaj ouvre la saison danse du Théâtre des Champs-Élysées dans le cadre de la saison TranscenDanses avec Winterreise, Le Voyage d’Hiver de Franz Schubert. La pièce a été créée pour le Ballet du Théâtre de La Scala de Milan en janvier 2019 et reprise par sa compagnie en juillet lors du festival Montpellier Danse. Le chorégraphe a bâti sur le cycle de 24 lieder écrits sur des poèmes de Wilhelm Müller une chorégraphie puissante, offrant une plongée dans les émotions portées par le piano de James Vaughan et la voix du baryton Thomas Tatzl. Le chorégraphe français sera également à l’affiche de l’Opéra de Paris à la fin de l’année avec la reprise très attendue de sa pièce Le Parc créée en 1994 et qui verra sur scène une nouvelle génération d’interprètes. Angelin Preljocaj évoque à bâtons rompus la genèse de ce Voyage d’Hiver, son travail autour de la musicalité, son idée d’un répertoire et ses souvenirs de la création du Parc.

Angelin Preljocaj
Qu’est-ce qui vous a amené à chorégraphier sur ce cycle de lieder de Schubert Winterreise ? C’est une musique qui vous accompagnait depuis longtemps ?
Oui, ça fait partie d’une playlist secrète où il y a mes projets à venir, avec des oeuvres musicales que j’affectionne particulièrement. Et Winterreise en fait partie. Cela s’est joint à une commande de La Scala d’une création pour musique de chambre. Je me suis dit que c’était le moment de sortir ce joyau et de travailler dessus, avec cette belle opportunité de le faire à La Scala de Milan d’abord, puis avec ma compagnie.
Vous avez choisi la version pour baryton qui confère au cycle une profondeur différente.
Absolument, je voulais la version pour baryton. J’aimais beaucoup la version de Dietrich Fischer-Dieskau qui est magnifique. Et c’est d’ailleurs sur celle-là que j’ai travaillé avant que n’arrive Thomas Tatzl pour les répétitions finales. Cette version pour baryton donne une gravité supplémentaire.
Et quand vous avez proposé ce travail à Thomas Tatzl, il a été enthousiaste ?
Oui. Il est en pleine ascension, il est maintenant distribué sur de nombreuses scènes en Europe. Il est formidable et c’est une gageure de chanter ces 24 lieder sur scène.
C’est sur la musique que j’ai écrit la danse avec ce piano qui est d’une richesse inouïe
Comment avez-vous travaillé ? Vous vous êtes directement inspiré des textes du poète Wilhelm Müller pour créer la chorégraphie ?
Oui, mais d’une manière plutôt impressionniste, c’est-à-dire de façon pas du tout narrative. Je n’ai pas voulu raconter l’histoire de cet homme. Impressionniste, parce que j’ai pris en compte mes impressions à la lecture du poème et surtout mes impressions musicales. C’est sur la musique que j’ai écrit la danse avec ce piano qui est d’une richesse inouïe. Quand on l’écoute, on peut avoir l’impression d’une certaine monotonie. Mais en réalité, quand on l’écoute attentivement, il y a une énergie et une variété rythmique dans le piano et une subtilité incroyable, et c’est là-dessus que j’ai travaillé. Je me suis dit que c’était la seule solution pour que le spectacle rebondisse d’un chant à l’autre plutôt que de se laisser emporter par cette espèce de mélancolie tout au long du ballet, je voulais éviter ça. Je voulais faire en sorte que l’on puisse voyager à travers ces 24 lieder avec une sensation de découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau, aussi bien gestuellement que dans l’atmosphère, passer du travail de groupe à un quatuor, puis un duo, un solo. Essayer de varier les plaisirs en somme ! Et d’ailleurs, dès que j’ai évoqué ce projet à La Scala, j’ai tout de suite précisé : “Détrompez-vous ! Je ne vais pas faire un duo et un solo“. Ce n’est pas parce que c’est une oeuvre très intime qu’elle doit être confidentielle, j’ai demandé que ce soit une pièce pour au moins douze danseurs et danseuses.

Winterreise -Angelin Preljocaj
Mais cette division de la partition en 24 entités, 24 chants, cela a tout de même dicté votre écriture chorégraphique ?
Oui, mais c’est intéressant car je n’avais jamais travaillé de cette façon, avec cette succession de vignettes, avec même le temps entre les chants que je pense nécessaire. Peut-être qu’il peut sembler parfois pesant mais on n’enchaine pas les choses comme ça. Il faut à la fin d’un lied une respiration, quelque chose qui se termine, qui doit se re-déposer. Et ce temps, j’avais envie de l’intégrer dans le spectacle, qu’il apporte son poids, aussi sans avoir peur de prendre le temps de sortir, de s’arrêter, puis que quelqu’un entre et quelque chose de nouveau commence.
Comment avez-vous fait travailler les interprètes ? Vous leur avez demandé aussi bien à La Scala qu’avec ceux de contre compagnie d’écouter les lieder, de lire les textes de Müller ?
À vrai dire, quand j’ai travaillé à Milan, j’étais dans un timing très serré : ils étaient dans Casse-Noisette et je devais prendre le créneau entre les représentations. J’avais un temps très très court, je devais faire un Lied tous les deux jours, créer la matière, l’organiser, l’écrire, faire le contrepoint, etc. C’était donc très très intense. Mais du coup, cela m’a mis dans une espèce d’état fébrile et de créativité très intéressant, j’étais dans un état de prolixité. Et les danseurs et danseuses ont très bien réagi à La Scala. Ils étaient passionnés, ils m’ont vraiment donné beaucoup d’énergie, ils étaient très avides et cela m’a réellement stimulé.
Il y a aussi une difficulté particulière pour les danseuses et les danseurs de danser sur une partition où se mêlent chant et piano.
Oui, et d’ailleurs parfois il y a des confusions. Mais avec ma compagnie, cela s’est aussi très bien passé parce qu’ils sont très accoutumés à mon style et j’ai pu vraiment aller à l’épure. J’aime beaucoup l’interprétation de La Scala. Elle était sans doute un peu plus brute aussi, c’est dû aux conditions de production. Mais c’était aussi très agréable de retrouver mes danseurs et danseuses et d’avoir eu le temps de tout peaufiner et de travailler très en détails.
Il y a deux ans, lors du festival Montpellier Danse, vous aviez repris avec votre compagnie les pièces que vous aviez créées pour le New York City Ballet dans un programme intitulé Pièces Américaines. Cette fois-ci, le projet était conçu simultanément pour une grande compagnie classique de La Scala et votre compagnie.
J’ai tout de suite joué cartes sur tables avec La Scala. Je leur ai dit que j’étais d’accord pour réaliser une création à condition que je puisse la reprendre avec ma compagnie, car j’étais aussi en discussion avec Jean-Paul Montanari, le directeur de Montpellier Danse, qui voulait que l’on revienne. C’était ma seule possibilité. Et au fond c’est très bien car ces compagnies classiques jouent beaucoup à la maison alors que nous, nous sommes une compagnie de tournée. Nous faisons un certain nombre de dates chez nous à Aix-en-Provence mais le reste du temps, on est en voyage. Et moi je suis pour que les oeuvres vivent et qu’elles soient vues. La négociation s’est parfaitement déroulée avec La Scala, les décors et costumes viennent de Milan. C’est un partenariat que nous avons instauré.

Winterreise – Angelin Preljocaj
Le Voyage d’Hiver est une pièce sombre et même morbide avec la mort constamment présente au fil des 24 Lieder. Vous semblez avoir contourné cette morbidité en proposant une pièce allégée de cette référence constante à la mort.
Pendant les douze premiers lieder, la mort est là, constamment. Dans le second volet que Schubert a écrit plus tard, il a changé la tonalité. On est alors dans quelque chose où surgit l’espoir, même si irrémédiablement, on retourne vers la mort. Il y a des couleurs d’automne qui sont évoquées, des souffles de survies qui jaillissent et qui s’éteignent à nouveau et j’ai voulu rendre cela, profiter de ces courtes rédemptions.
C’est une pièce grave mais le public réagit de manière très enthousiaste.
Je suis très étonné car je pensais que c’était une pièce exigeante et ça l’est pour les interprètes, le chanteur et le pianiste. Je pensais que ça allait l’être pour le public et auditeur. Même écouter les 24 lieder de Winterreise en concert, c’est une exigence. Je ne croyais pas que la réaction allait être aussi spontanée.
Il y a des couleurs d’automne qui sont évoquées, des souffles de survies qui jaillissent et qui s’éteignent à nouveau
Il y a ce constant va-et-vient entre la scène et le plateau, entre les interprètes sur scène, le pianiste et le chanteur dans la fosse.
Oui, c’est une triangulaire et il y a cette sensation de refaire vivre ensemble ce moment qui est très agréable et qui touche au rituel, en quelque sorte : le fait de faire ensemble quelque chose. Et le rituel, c’est quelque chose qui est très important, je crois, dans la notion du spectacle vivant. Parce que finalement, le public rentre aussi dans ce contexte.
On vous retrouvera aussi en cette fin d’année sur la scène du Palais Garnier avec la reprise de votre ballet Le Parc créé il y a 25 ans. Quels souvenirs avez-vous de la création ?
J’ai tout d’abord le souvenir des interprètes avec qui je l’ai créé, Laurent Hilaire et Isabelle Guérin, et toute la troupe de l’époque qui était magnifique. Et ce moment de grâce : c’est une création qui s’est passée magnifiquement. Quand je suis arrivé, j’étais très impressionné, j’étais tout jeune chorégraphe. Et quand on démarre, on veut toujours prouver que l’on sait faire. Je préparais beaucoup les répétitions, je ne voulais pas que les danseurs et danseuses se désinvestissent parce que je pensais que ce que je leur proposais n’était pas tout à fait leur culture . Dès le début, j’étais très exigeant, comme toujours d’ailleurs, mais d’une façon plus anxieuse. Mais après une semaine, il y a une confiance qui s’est installée et j’ai pu aller très très loin avec eux. C’était une très belle aventure…
La seule façon de réactualiser les oeuvres, c’est de les confier aux interprètes et de leur donner l’espace d’habiter cette oeuvre en relation avec notre histoire contemporaine
Vous n’êtes plus le même artiste qu’il y a 25 ans. Et quand on reprend un pièce comme Le Parc, quel regard porte-t-on sur son propre travail ? A-t-on envie de la retoucher de la revoir pour d’autres interprètes ?
Je pense beaucoup depuis plusieurs années à l’idée de l’interprétation. Qu’est-ce que c’est qu’interpréter une oeuvre ? Si je considère Le Parc par exemple, c’est ce que j’ai pu faire de mieux à ce moment-là. C’est un moment et c’est comme ça. Et je ne veux pas le changer chaque fois, sinon on perd l’essence de la chose. Et on risquerait alors de se retrouver avec quelque chose qui n’a plus de sens. Je crois que c’est une erreur à éviter.
Comme disait Marcel Duchamp : “L’art d’une époque n’est pas le goût de cette époque “. C’est une phrase très importante que peu de gens ont en tête. Les artistes devraient réfléchir à cela parce que quand on crée une chose, on fait une chose qui est propre à son art qui est lié à une époque. On est là imprégné d’une époque : ce n’est pas le goût de l’époque, c’est l’art de l’époque. Quand on revient deux ans, cinq ans ou dix ans après, la tentation est d’adapter cela au goût de l’époque. On change alors de paradigme : on passe de l’art d’une époque au goût d’une époque. Et c’est là que l’on commence parfois à détruire les oeuvres. La seule façon de les sauver et de les réactualiser de mon point de vue, c’est de les confier aux interprètes et de leur donner l’espace d’habiter cette oeuvre en relation avec notre histoire contemporaine. Et c’est exactement ce que j’ai fait avec Roméo et Juliette ou Blanche-Neige. Chaque fois qu’un ballet est repris, parfois avec des danseurs et danseuses qui n’étaient pas nés au moment de la création, on me dit “Ah! Ça n’a pas pris une ride”. Mais ce sont les interprètes qui redonnent une nouvelle appétence, une nouvelle essentialité à cette oeuvre, parce que ce sont des gens d’aujourd’hui.

Le Parc d’Angelin Preljocaj – Eleonora Abbagnato -avec le Ballet de l’Opéra de Rome
Cette idée du répertoire et de sa préservation, vous y êtes sensible ?
Ah oui ! J’y tiens. Une oeuvre qui n’est pas dansée est une oeuvre qui meurt. Je suis pour la diffusion des oeuvres. Et quand une compagnie de qualité me demande d’intégrer une pièce à leur répertoire, en général je dis oui parce que je sais que ce sera dansé à nouveau et ce sera une nouvelle version, une nouvelle vision, une nouvelle interprétation. Je crois très sincèrement que les oeuvres s’enrichissent par l’interprétation et que chaque nouvelle interprétation ajoute une couche à ce millefeuille mystérieux qu’est une oeuvre. Et une oeuvre qui reste, c’est une oeuvre qui est nourrie.
Eléonora Abbagnato, une interprète particulière du Parc, a choisi de faire ses adieux sur ce ballet le 23 décembre…
C’est une grande complice, j’attends ce moment avec impatience.
Winterreise d’Angelin Preljocaj par le Ballet Preljocaj au Théâtre des Champs-Élysées du 3 au 5 octobre dans le cadre de la saison TranscenDanses, en tournée en France.


