
Biennale de la Danse 2016 – Dominique Hervieu : “En tant qu’artiste, je suis heureuse d’être utile.”
Quand j’ai rencontré Dominique Hervieu pour l’interroger sur sa foisonnante 17ème Biennale de la Danse de Lyon, le mois d’août touchait à sa fin et la décision d’enceindre le Défilé dans le stade de Gerland venait d’être prise. Imaginez, douze groupes réunissant 4.500 amateurs et 250 artistes, et quelques maigres semaines pour tout réorganiser ! Mais bien loin de se lamenter, elle préférait s’émerveiller de la motivation, du dévouement de ses équipes et de tous les participant.e.s. Voilà qui ressemble trait pour trait à cette femme engagée, volontaire, qui fut danseuse et chorégraphe avant de diriger le Théâtre de Chaillot puis la Biennale et la Maison de la Danse de Lyon, et dont la bonne humeur et les rires n’ont cessé d’émailler notre entretien.

Dominique Hervieu, Directrice artistique de la Biennale de la Danse, et Directrice de la Maison de la Danse (Lyon)
Un des axes principaux de cette 17ème Biennale de la Danse de Lyon, la troisième sous votre direction, est le dialogue entre danses savante et populaire. Pourquoi ce choix ?
Cela vient de ce que j’entends des artistes. C’est-à-dire que ce n’est pas moi qui aurais, tout à coup, une espèce de question métaphysique qui me tomberait dessus. Au fur et à mesure de mes discussions avec eux, qui démarrent deux ans avant la Biennale, se dégage un sujet qui me semble pouvoir créer un lien entre toutes leurs œuvres. Là, le thème danse savante, danse populaire s’est dégagé de manière très évidente. Ces thématiques permettent au public de partager avec nous une question esthétique. Et puis se développe tout autour un travail critique, de réflexion, comme le fait l’Université Lyon 2 avec un genre de colloque qui s’intitule La danse, juste pour le plaisir ? Tout est un peu éditorialisé autour de ces questions.
Je voulais sortir de cette séparation entre l’art sérieux, qui peut-être manquerait d’invention sur le plan formel et sur le plan du langage corporel, et au contraire la fantaisie, qui elle manquerait de fond. On peut totalement rassembler un haut niveau artistique et d’engagement esthétique, une démarche purement chorégraphique de langage et d’écriture, et les mettre au service d’un propos. C’est ce que j’aime que cette Biennale porte.
Quels seront les temps forts de cette thématique ?
La dimension populaire y est vraiment protéiforme. Il n’y a pas une seule façon de la convoquer, c’est au contraire très contrasté. Quand il s’agit du Groupe Acrobatique de Tanger, par exemple, c’est populaire au sens où ils retrouvent les fondamentaux de leur langage, d’une pratique un peu en voie de disparition : l’acrobatie arabe. Dans leur parcours, ce langage a quelquefois été arrondi, occidentalisé. Ils s’y sont de moins en moins retrouvés par rapport à leur patrimoine gestuel. Ils travaillent aujourd’hui avec un ancien acrobate qui a 80 ans, sur la plage, à Tanger. Ils avaient un vrai désir de retourner aux sources. Ces vocabulaires qui sont en train de disparaitre deviennent des points d’appuis pour l’invention, pour la création actuelle. Je les aime bien, c’est une belle compagnie. Mais ce qui m’intéressait avant tout, c’est qu’ils m’ont dit avoir adoré travailler avec Aurélien Bory ou Zimmermann et de Perrot qui ont fait de très belles créations, mais que finalement ces spectacles avaient beaucoup de mal à tourner au Maroc, chez eux. Ils se sentaient coupés d’une attente du public, d’un lien culturel qui rassemble.
Pour eux il y avait donc deux enjeux, retrouver les racines de leurs mouvements et une présence au Moyen-Orient, régionale, qui est aussi très importante. À cela il faut ajouter leur envie d’être auteurs de leurs spectacles. Avec Halka ils le sont, sous forme de collectif. Abdeliazide Senhadji, de la Compagnie XY, est très présent, les suit, mais il est au second plan. C’est donc également une forme d’émancipation politique et esthétique. Pour eux, le populaire prend le sens de retour aux sources et en même temps d’émancipation, ce qui est très bien.

Halka du Groupe Acrobatique de Tanger
Si l’on parle de danse populaire, on pense aussi au travail Christian Rizzo…
Evidemment il y a aussi Le sydrome ian de Christian Rizzo. Parce que c’est Christian qui, avec d’après une histoire vraie, a donné ce qu’on pourrait appeler le coup d’envoi. C’était extrêmement réussi, très assumé, argumenté, théorisé. Après un détour du côté de la danse de salon, avec ad noctum, il continue cette fois avec la danse de club. On peut donc dire qu’il est vraiment la colonne vertébrale, depuis trois ou quatre ans, de cette envie de retrouver des vocabulaires anonymes. Lui appelle ça les danses anonymes, c’est encore autre chose, justement l’envie de ne pas être auteur. Ce que je trouve bien c’est que la dimension de club, avec Christian Rizzo, s’associe finalement à l’idée d’autobiographie. Après sa période très conceptuelle, plasticienne, ce qu’on appelle le retour au mouvement, s’ancre pour lui dans son histoire. Il a été un clubbeur pendant longtemps, a une passion pour les boîtes de nuit. C’est donc comme si tout à coup, il y avait réconciliation entre la dimension sensuelle, gratuite, purement physique et pulsionnelle de la danse de club, et la dimension d’écriture, évidemment savante. C’est très intéressant aussi. Cela donne encore un angle différent à cette thématique, que je vois comme un panorama et non un manifeste.
Et puis il y a aussi la création de Cecilia Bengolea et François Chaignaud. Il n’y a que des temps forts pour moi (rires) ! Dans cet exercice de métissage qui est leur marque de fabrique, ils travaillent sur la tension entre deux registres qui n’ont rien à voir : le dancehall, qui est de la contre-culture jamaïcaine très engagée, et des chants polyphoniques géorgiens moyenâgeux. Ils convoquent un répertoire éloigné de nous, qui a une dimension de rue, une forte mission politique, et le catapultent, le croisent avec un répertoire totalement différent, d’une autre époque. Evidemment, l’hybridation de formes complètement inattendues fait de beaux points d’appui pour l’invention.

Cécilia Bengolea
Cette 17e Biennale propose aussi des comédies musicales. Pourquoi ce choix ?
La comédie musicale, c’est encore autre chose, comme registre noble populaire. Elle est prise en charge par deux démarches très éloignées. Jean-Claude Gallotta, pour Volver, est parti de chansons d’Olivia Ruiz et réalise avec elle une sorte de fiction autobiographique, dont la chanteuse est l’héroïne. Quant à Yan Duyvendak, il a une démarche très conceptuelle, théorique, dont le point de départ est extrêmement audacieux et clair. Sound of Music parle des principaux maux de notre société : le suicide des jeunes, le chômage, les difficultés au travail, les problèmes écologiques, économiques. Il s’est énormément documenté, est parti d’articles de journaux ou de publications de l’ONU etc. et a mis tout ça en musique et en danse ! Ce registre léger, fantaisiste, glamour – parce qu’il y a tout, les paillettes, l’interprétation très frontale, directe et sensuelle – crée là aussi une tension entre le fond et la forme. Le fond est très politique, engagé, pessimiste, terriblement lourd, et la forme est terriblement légère.
Yan Duyvendak fait partie des gens avec qui j’ai discuté très tôt. Quand je lui ai demandé pourquoi la comédie musicale, il m’a répondu : “Parce que c’est beau, parce que ça fait du bien“. C’est lui qui m’a un peu servi de point de départ, il est très emblématique. Il y a chez lui le mariage du plaisir esthétique et du sens. Bien sûr que l’on peut dire des choses graves, qu’il faut dire des choses actuelles, être dans la création avec une force critique qui peut avoir une dimension politique assumée. Mais en même temps, tout ça ne se résout pas forcément dans un rapport au spectacle tendu, dans une espèce d’art politique qui manquerait de plaisir esthétique. Il parle du Titanic, sur lequel des gens continuaient de danser, de jouer de la musique alors qu’il coulait. C’est ce qu’il voit du monde d’aujourd’hui et je trouve que l’image est belle. Finalement, cela donne un spectacle un peu embarrassant, déstabilisant. Dans ce spectacle, Olivier Dubois et Michael Helland, un artiste suisse, ont chorégraphié pour 12 interprètes auxquels se joignent une vingtaine d’élèves du Conservatoire de Lyon. Il y a cette jeunesse pleine de vie qui déboule sur scène, avec ce texte si noir… Mais parce qu’il faut rester debout et en vie, c’est l’énergie qui, quand même, termine le geste du spectacle.

Sound of Music de Yan Duyvendak
Tout finira avec le Battle of styles. Comment est venue cette idée ?
C’est une idée qui vient de Dresde et que je regrette de ne pas avoir eue, que l’on verra pour la première fois en France. Quelle est la plus populaire des danses aujourd’hui ? C’est évidemment le hip-hop. Et qu’est-ce qui est le plus populaire dans le hip-hop ? Les battles. Quatre équipes de quatre excellent.e.s danseur.se.s de styles totalement différents (hip-hop, néoclassique, contemporain) s’affronteront. Nous aurons de façon festive et concrète un laboratoire de mélange sous les yeux, puisque petit à petit les équipes s’hybrideront. À la fin, on aura une équipe composée de deux Preljocaj, un Forsythe et un Pockemon Crew !
Ce thème savant populaire, et plus encore ces réjouissantes battles qui mêlent des interprètes des Pokemon Crew, des Saxonz, du Ballet Preljocaj et de William Forsythe, n’est pas sans rappeler votre travail lorsque vous chorégraphiez avec José Montalvo.
Exactement, oui. Vraiment tout à fait, c’est raccord (rires).

Battle of styles
Cette édition met aussi à l’honneur les interprètes des grands chorégraphes du XXème siècle. Cristiana Morganti, Louise Lecavalier, Jonah Bokaer et Olivia Grandville présenteront leurs créations. Ils évoqueront également leur parcours de danseur.se.s dans le cadre de Dancers Studio, inspiré de l’émission américaine Inside the Actors Studio, à voir sur votre site. Regrettez-vous que la danse contemporaine, contrairement à la danse classique, ne mette que très rarement les projecteurs sur ses interprètes ?
Oui, c’était en partie pour répondre à une forme d’injustice (rires) ! En tant que danseuse contemporaine, je sais ce que les interprètes apportent dans les créations. C’est complètement paradoxal, parce qu’à la différence des danses de répertoire, il y a beaucoup de l’imaginaire de chacun dans les œuvres contemporaines, énormément d’apport sensible des danseur.se.s. Et en effet, quelques fois je trouve qu’ils ne sont pas assez récompensés pour cette collaboration très intime. Il arrive qu’ils soient quasiment co-auteurs. C’est donc un peu pour leur rendre hommage. D’ailleurs, pour moi le Battle of styles est dans le même ordre d’idée. C’est un évènement chorégraphique qui se passe de chorégraphe, les danseur.se.s suffisent ! Ça va de paire, il s’agit de montrer que la mise en jeu sensible de grands interprètes, qui ont des parcours très riches, est déjà très spectaculaire. Mais j’adore les chorégraphes aussi, ce n’est pas en opposition.
Vous avez été les deux de toutes façons, on ne peut pas vous taxer de partialité.
Ni me mettre dans une case. Mais voilà, j’ai trouvé que c’était bien que des noms de grands interprètes circulent pour eux-mêmes. Un fait aussi : tous les gens présents sont des orphelins. Cristiana Morganti de Pina Bausch, Jonah Bokaer de Merce Cunningham, Olivia Grandville de Dominique Bagouet et Louise Lecavalier d’Edouard Lock, car même si, bien sûr, il est encore vivant, il ne chorégraphie plus. L’idée est donc de présenter des artistes qui ont été extrêmement investis dans la démarche d’un.e auteur.rice, et qui aujourd’hui prennent le relai de la création. Ils empruntent tous des voix différentes. Crisitiana Morganti est dans une espèce de registre du portrait, très intimiste, magnifique. C’est doux, c’est tendre, c’est sincère, quelle artiste ! On sent qu’elle est dans la restitution d’une expérience avec Pina Bausch. Olivia Grandbille, elle, est complètement ailleurs ! Jonah Boaker est un héritier de Merce Cunningham. Sa démarche, comme celle du chorégraphe, est l’addition d’univers plastiques, de musique et de chorégraphie. Il travaille avec Daniel Arsham qui est un excellent plasticien, et Pharell Williams est son John Cage. Quant à Louise Lecavalier, elle est dans cette dimension d’énergie que lui a donné Edouard Lock, mais complètement à sa façon. Ils proposent donc quatre manières de résoudre la question de l’héritage. Connaissez-vous l’émission de l’Actors Studio ?
J’ai vu quelques extraits.
Elle m’a vraiment nourrie, je regardais tous les Actors Studio ! Voir ces monstres, Al Pacino etc. qui parlent de leur art, quand on est un jeune interprète… Il y a une espèce de mise en jeu, de profondeur, de générosité chez ces gens-là qui m’a beaucoup construite. Alors je me suis dit qu’il fallait que les jeunes du Conservatoire de Lyon aient leur Dancers Studio, pour voir ce que c’est que des grands (rires) !

RECESS de Jonah Bokaer
Parlons maintenant du Défilé, qui est toujours un grand moment, un temps fort de la Biennale. J’ai lu que vous aviez décidé de l’appeler Ensemble ! avant que démarre cette terrible série d’attentats qui a endeuillé la France. Aujourd’hui, cet intitulé prend une valeur symbolique particulière.
Oui, très tristement !
Vous avez annoncé qu’il se tiendrait finalement dans l’enceinte du stade de Gerland. À quel moment avez-vous pris cette décision ?
Le 24 août. C’était ça ou une annulation pure et simple. Parce qu’un parcours comme ça est impossible à sécuriser. Et c’est vrai que le Défilé est un symbole. J’appelle ça un laboratoire de diversité culturelle et sociale. C’est vraiment de la mixité sociale, c’est le sujet. C’est un laboratoire, un outil pour élaborer cette diversité, donc évidemment, y renoncer… C’est pour ça que je l’ai appelé Ensemble ! Et en effet, je me suis dit que les gens pourraient penser que je faisais preuve d’opportunisme. Mais en fait, comme nous tous, je sentais que le monde n’allait pas bien, même si je ne savais pas à quel point ce serait tragique. Maintenant nous essayons d’incarner au mieux ce thème.
Je crois vraiment à la danse comme apprentissage de l’altérité, de l’ouverture aux autres, parce que c’est un art de la relation.
Cela renforce le sens et l’utilité de ce Défilé. En tant qu’artiste, je suis heureuse d’être utile. Son exemplarité est importante aussi, parce que nous recevons beaucoup d’argent de la ville, et c’est gratuit, il n’y a pas de recettes. C’est vraiment un outil politique, vers la culture. Il est très important que tout ça, non seulement existe, mais se développe. Dans ces moments terribles que l’on traverse, j’y crois énormément. Je crois vraiment à la danse comme apprentissage de l’altérité, de l’ouverture aux autres, parce que c’est un art de la relation. C’est aussi un art avec lequel on peut faire comprendre aux gens l’enrichissement de la diversité dans un projet commun. Le Défilé a cet équilibre. D’un côté tout le monde est différent, c’est vraiment très mélangé et c’est génial, ils sont quand même 4.500 personnes, et de l’autre il y a une unité, puisque c’est une chose que l’on fait ensemble. C’est un projet d’éducation, un projet de culture. La diversité est au service de l’unité, en maintenant la singularité chez chacun, sa fantaisie, son imaginaire, sa folie festive. On est vraiment dans une parade d’expression, mais en même temps avec des règles communes, une philosophie commune. On a absolument besoin qu’il y ait ces moments d’espoir, ces moments où c’est possible.
Ce que vous dites rejoint totalement le thème de la journée qui est organisée avec Libération, “Quels nouveaux liens inventer entre les artistes et la population pour que la culture permette de faire société ?“. Comment, selon vous, la danse pouvait lutter contre la monté des populismes et communautarismes ? Ce que vous racontez du Défilé est une façon d’y répondre.
Oui tout à fait. Il faut lutter par l’action. J’ai fait un projet il y a un an à la Maison de la Danse qui s’appelait Babel 8.3, avec des gens qui, pour la plupart, n’avaient jamais dansé, très éloignés de la culture, des gens du 8ème arrondissement, le plus pauvre de Lyon. Il s’agissait de la création d’un spectacle, avec 300 amateurs répartis en douze groupes. Nous étions accompagnés par vingt musiciens de l’ONL, leur partition n’était que du Mozart. Le niveau d’exigence était très élevé, cela représentait 1.000 heures d’intervention. Ça s’est extrêmement bien passé, c’était un beau projet. Il y avait dix chorégraphes et j’ai mis en scène l’ensemble. Le plus jeune des participants avait 5 ans, la plus âgée avait 98 ans. C’était un vrai Babel !
En effet là c’est un vrai brassage…
Ah oui, un vrai brassage ! Et ce que je veux dire par l’action, c’est ça. Aujourd’hui le militantisme, dire “On décrète que l’on va vivre ensemble“, ce n’est plus possible. On ne peut pas dire “Allez on vit ensemble“. Ça s’élabore ! C’est comme l’éducation artistique. Vous devez le savoir si vous connaissez un peu mon parcours, je suis une militante. J’ai toujours dit que la sensibilité esthétique s’éduquait. Pour le vivre ensemble, c’est la même chose, c’est de l’élaboration, et pas une espèce de théorie. Je pense qu’aujourd’hui tous ces mots d’ordre ne servent à rien. Le vrai truc, c’est l’action, c’est d’éprouver les choses. Nous, les artistes, mais aussi les institutions car les artistes ne peuvent pas avoir tout sur le dos, nous devons nous tourner vers les gens, de façon très volontariste, vers les gens exclus. On ne peut pas continuer à sensibiliser les gens déjà sensibles ! Il y a un travail de responsabilité, de coresponsabilité, à avoir sur à qui l’on s’adresse. Et c’est vrai que le Défilé et Babel, quand on va chercher les gens un par un… Quand je suis arrivée à Lyon – il faut avoir des images positives, des ancrages un peu fantasmatiques pour se lancer dans une aventure – je me suis dit : “Je suis la chorégraphe de la ville“. Et je suis là (rires), je vais mettre 300 personnes par ici, et 40.000 dans un stade !
Comment recrutez-vous, d’ailleurs, pour de tels projets ?
Le Défilé est un peu une institution. Tellement de gens ont envie de danser ! Ils ont vu leurs copains, il y a des classes, des villes dont c’est le projet culturel. Le Défilé est très vertueux du point de vue de la construction de la politique culturelle, cela permet à certaines villes d’avoir un projet tout trouvé, de s’appuyer sur nous. Et pour Babel c’était certaines fois en bas des immeubles, convaincre les parents que la petite fille pouvait danser sur scène etc. C’était quelques fois du cas par cas, des moments d’attention les uns aux autres. Je faisais répéter les 300 participants tout un week-end, pendant des heures. C’était très impliquant. Quand ils ont vu les musiciens de l’ONL dans la fosse, ils étaient très fiers, dans le bon sens du terme, être heureux de ce qu’on produit. C’est un boulot fou que jamais on ne regrette. L’on peine à chaque fois, mais dès que l’on a fini, on se dit qu’il faut recommencer (rires) ! Et aujourd’hui, c’est extrêmement utile.
Le directeur de l’éducation de l’OCDE, le papa de PISA, était présent. Il a écrit des choses extrêmement élogieuses sur ce projet. Et en particulier que l’art peut réussir à déboulonner un peu des rigidités identitaires et intellectuelles, par l’invention, par l’imaginaire. Et que lorsqu’on y parvient, ce sont des valeurs durables. On est tenté de se dire “Ils s’amusent un jour et après quand ils rentrent chez eux…” Mais ça ne se passe pas comme ça, j’en suis persuadée. Ce que l’on éprouve, ressent, ce qui est de l’ordre de l’expérience est acquis. On peut travailler sur les difficultés à se dessaisir de certaines certitudes pour pouvoir danser avec l’autre, même avec des enfants de 5 ans. Je suis totalement convaincue de la vertu de tels projets, de la durabilité des compétences relationnelles, de l’enrichissement du rapport aux autres, qui s’ancre durablement dans la vie des gens. Il faut le faire, il faut agir. Ça prend un peu de temps.
L’art peut réussir à déboulonner un peu des rigidités identitaires et intellectuelles, par l’invention, par l’imaginaire.
Pouvez-vous m’en dire un peu plus sur l’exposition corps rebelles qui se tiendra au Musée des Confluences du 13 septembre au 5 mars, et qui propose de comprendre la danse comme un langage universel, à travers des œuvres marquantes XXème siècle ?
Ce qui va être beau dans cette exposition, dont Agnès Izrine en est la commissaire, ce qui ressortira et m’intéresse beaucoup, c’est le rapport entre les créations et chacune des époques, des contextes, dans lesquelles elles naissent. Ce sera très sensible. C’est important aussi, pour sortir la danse d’un art décoratif, éthéré, hors du temps. Cela commencera avec Le Sacre du printemps, en 1913. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point les corps en mouvement incarnent une complexité sociale, sociologique. C’est très touchant de voir comment un être, un corps, absorbe une vraie complexité du monde dans lequel il vit, grâce à une écriture, un auteur etc. Le corps de 1913, n’est pas celui de 1980, ni celui d’aujourd’hui. Je trouve touchante cette capacité d’incarnation, et cette réconciliation, là aussi, du sensible et du corps vecteur de sens. C’est-à-dire que c’est sensitif, sensoriel et en même temps intelligible. C’est quelque chose qui n’est pas toujours très clair chez les spectateur.rice.s. Là, ils auront l’occasion de voir cette profondeur. Je pense qu’il est important d’acquérir petit à petit une posture cultivée par rapport à la danse. Sortir d’une consommation un peu festive pourrait-on dire. Même si c’est quelque chose que je ne méprise pas du tout. On peut aller une fois par an regarder un grand spectacle, y prendre du plaisir, pourquoi pas ?
Mais il arrive que ces grands spectacles soient une porte d’entrée, qu’après cette découverte il y ait l’envie d’aller plus loin, de connaître un peu mieux la danse ?
Tout à fait, et je suis donc très heureuse qu’il y ait cette exposition. Évidemment, mon rôle dans cette affaire est d’amener de la danse live. Il y aura ce fameux jerk, Bouchra Ouizguen va faire une performance. Et puis il y aura à l’intérieur du musée un studio, où les spectateur.rice.s pourront voir des danseur.se.s au travail, un lieu de création, de fabrication, jusqu’au mois de mars. Il faut absolument saisir cette opportunité rare de croiser, de faire rimer héritage, donc patrimoine chorégraphique, et création. De voir à quel point la danse n’est pas un art éphémère.
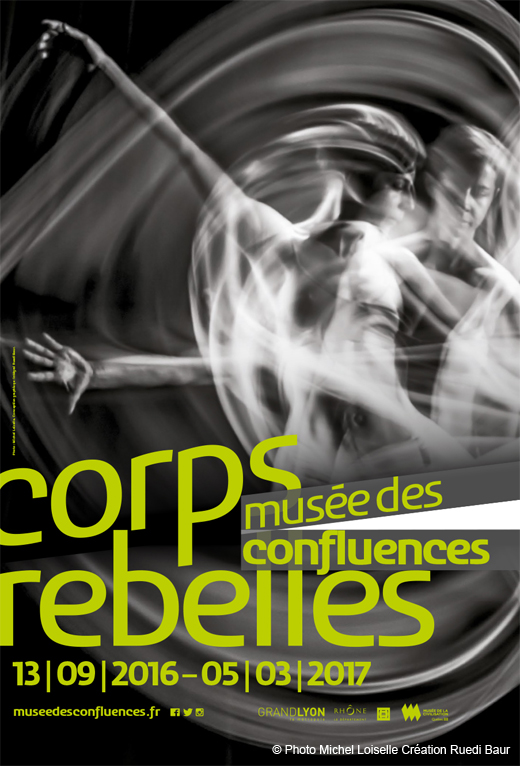
Affiche de l’exposition corps rebelles
Alors qu’entre l’édition 2012, date de la première Biennale sous votre direction, et l’édition 2014, la billetterie affichait une augmentation de 20 % de ses ventes, craignez-vous cette année une diminution de la fréquentation due au contexte actuel ? Même si les festivals semblent réussir à maintenir leurs publics.
Cela dépend des festivals. Les Nuits de Fourvière a un peu souffert des attentats, de la pluie, des grèves. Tout ça a pesé. Pour ne rien vous cacher, la billetterie de la Biennale était sur la place Bellecour, qui était devenue la Fan zone pour l’Euro de football, totalement barricadée ! Et à Lyon, il y a souvent une confusion entre Biennale et Défilé. Quand il y a eu l’attentat de Nice, des titres dans la presse annonçaient que la Biennale de la Danse était annulée, au lieu de se demander si le Défilé serait annulé. Alors il faut corriger ces problèmes de communication, rassurer les gens. Nous sommes en retard sur les ventes, mais en train de rattraper le retard. De toutes façons, il y a une baisse de budget importante, donc moins de jauge. Il y aura forcément moins de spectateurs puisqu’il y a moins de places dans les théâtres.
Est-ce dû à une chute des financements publics ou privés ? Et comment fait-on pour maintenir une programmation aussi foisonnante dans un tel contexte ?
Public et privé baissent ! Il y a un retrait de 6% de la Métropole et de la Région, l’Etat maintient sa subvention et le mécénat baisse de 28 %, ce qui est très important. Conséquemment les recettes baissent, puisqu’il y a moins de spectacles. C’est un peu la double peine quand on est dans le spectacle vivant. J’ai réagi en disant qu’évidemment, il ne fallait pas du tout aller vers une simplification ou une facilité, mais garder une Biennale internationale de création. Il y a cette année 21 créations ou premières françaises, l’équilibre entre création et diffusion est donc maintenu. C’est ce qui est important. J’ai raccourci pour garder le tempo, ce que j’appelle la parenthèse d’exception culturelle. Garder cette espèce d’énergie dans Lyon où l’un voit ceci, l’autre cela, où les expériences se partagent. Il faut maintenir cette frénésie.
J’ai dû travailler autrement. Puisqu’il y a moins de temps, j’ai pris plus d’espace. Vingt nouvelles villes participent à la Biennale. Il y a eu la grande Région, nous avons donc maintenant Clermont-Ferrand, Aurillac. Beaucoup de gens s’appuient sur la Biennale pour présenter des œuvres de danse, des SMAc (ndlr : Scènes de Musiques Actuelles) par exemple, qui osent présenter de la danse parce que c’est la Biennale. Nous les soutenons pour leur communication etc. Et je suis comme une espèce de conseillère artistique de mes collègues (rires). J’adore faire ça ! Surtout ce sont des gens de qualité, et grâce à ça il y a des artistes qui font de petites tournées de 4 à 5 villes.
Cela va peut-être permettre d’amener de la danse dans des territoires où il n’y en avait pas ?
C’est ce qui se passe ! C’est très intéressant sur le plan de la politique territoriale et de la diffusion des œuvres. Franchement j’aime faire ça, s’il n’y avait pas eu ces problèmes d’argent je l’aurais fait quand même. Nous avons un vrai rôle à jouer. Je vous l’ai dit je suis une militante. Il faut pousser les portes, ouvrir, mettre des danseur.se.s, et ça se passe bien ! nous proposons aussi tout le travail de numeridanse, bien sûr dans ces lieux-là. Et à la fin ça fait une stimulation joyeuse, généreuse, intellectuelle, sensible.
J’imagine que vous commencez déjà à penser à la prochaine Biennale. Ces problèmes de budget vous inquiètent-ils pour l’avenir ?
Bien sûr. Bien sûr oui. Ça ne peut plus descendre !
Et est-ce que ça pourrait remonter ?
Je n’en sais rien. Evidemment toutes les nouvelles qu’on a sur le plan des recettes publiques ne vont pas dans ce sens. Pas du tout. C’est absolument partout des économies. Après sur le plan du mécénat, ce n’est pas moi qui m’en occupe, je ne peux pas dire.
Arrivez-vous malgré tout à expliquer pourquoi une telle baisse ?
Aujourd’hui tout le monde cherche de l’argent, le secteur de la santé, de l’éducation, les diversités, c’était moins le cas il y a 10 ans. Et puis il y a un attachement de plus en plus fort aux valeurs philanthropiques et sociales, ce que l’on peut vraiment comprendre, la bataille contre l’illettrisme, le sport pour vaincre la violence etc.
Oui mais nous en avons en a parlé, l’art peut faire partie de ces valeurs, être un outil également.
Oui c’est un outil, et on peut en effet plus orienter le mécénat sur le rapport entre champ social et culture. Mais il y a tellement de guichets ouverts qu’il faut évidemment partager. Et puis certaines entreprises sont fragilisées, prennent leur temps. Mais pour la Biennale, il ne faudrait plus, du tout, que ça baisse, il faut maintenir le budget artistique à tous prix !
Beaucoup de gens s’appuient sur la Biennale pour présenter des œuvres de danse.
La Biennale de la danse est celle de tous les styles, du néoclassique au hip-hop. Mais vous qui étiez une jeune interprète dans les années 1980 et avez plus tard codirigé le CCN de Créteil, que pensez-vous de la déclaration choc de Jean-Paul Montanari, directeur de Montpellier Danse, qui annonçait cet été la mort de la danse contemporaine ?
Je n’ai pas du tout le même sentiment. D’après les informations que j’ai, il y a plus de public pour la danse aujourd’hui que dans les années 1980. C’est ce qui ressort dans les discussions avec mes collègues, avec le Ministère etc.
C’est une bonne nouvelle !
C’est une bonne nouvelle et cela ne m’étonne pas. Dans les années 1980, il y avait très peu de danse sur les Scènes Nationales par exemple. Aujourd’hui, il y a au moins trois spectacles par an. Certes, ce n’est pas assez, on aimerait bien qu’il y en ait dix, mais enfin, il n’y a plus de Scènes Nationales sans danse. Je programme à la Maison de la Danse toute l’année, nous recevons 150 000 spectateurs par an. J’ai aussi beaucoup milité pour le Théâtre de Chaillot, pour que la danse ait sa place dans un Théâtre National. Nous avons montré que c’était possible, que le public était là et qu’il y avait un vrai foisonnement, un vrai intérêt artistique, une vraie légitimité. Je me place plutôt de ce côté-là. Peut-être en effet y a-t-il moins de grands formats. Dans les années 1980, il y avait cette danse festive, ou alors expressionniste, comme Joëlle Bouvier par exemple, ou Maguy Marin avec son May B, ou Karine Saporta très spectaculaire. Après il y a eu une dimension réflexive, de déconstruction, qui a beaucoup été orientée vers des plus petits plateaux. Toujours est-il que j’ai une salle à Lyon avec une jauge de 1.200 spectateurs, dans laquelle nous recevons 40 œuvres par an. Pour cette Biennale, nous en avons 37.
Tout le travail qui a été fait a donc finalement porté ses fruits ?
Le travail a en effet porté ses fruits et je pense que, par rapport aux années 1980, il y a eu aussi une diversification incroyable des approches. Avec José Montalvo, nous étions à la fin des 80′ dans une période hédoniste, ludique, où tout était possible. Évidemment depuis le monde a beaucoup changé et de nouveaux registres sont nés. Le hip-hop notamment est arrivé sur les scènes françaises vers 1995. Je me souviens avoir cette année-là partagé l’affiche avec Mourad Merzouki. C’était son premier spectacle, Käfig, qui est devenu le nom de sa compagnie. Il y avait Montalvo-Hervieu en première partie, Mourad Merzouki en seconde. Le hip-hop est quand même un vrai phénomène. À l’époque, tout le monde disait que c’était une mode, que ça ne sera jamais une matière à écriture. On a vu avec Mourad Merzouki, avec Kader Attou, avec d’autres que c’est devenu un art à part entière, qui dialogue avec des décors, une scénographie, une dramaturgie, une musique. Un art qui a beaucoup fait, aussi, pour la mixité sociale dans nos salles. Alors merci au hip-hop, il faut quand même lui reconnaitre cette force-là. Je le vois à la Maison de la Danse et c’était le cas également quand je programmais à Chaillot. Son public est plus diversifié, plus mixte. Je dis bien mixte, pas un public de banlieue. Cela signifie que tous les âges, toutes les cultures, et toutes les couches de la société suivent cet art, c’est un phénomène très important.
Depuis les années 80, il y a une diversification incroyable des approches.
Je programme également beaucoup de nouveau cirque. Nous avons parlé du Groupe Acrobatique de Tanger, Yoann Bourgeois fera une création dans le stade de Gerland avec le Défilé, James Thierrée était présent à la dernière Biennale. Il y a eu une explosion de cette discipline, que j’apparente aux arts du mouvement, et qui est passionnante. Le néoclassique lui aussi revient à sa façon, et je pense que beaucoup de choses vont se passer dans les ballets. Et puis il y a aussi toute cette danse conceptuelle, qui a compté. À un moment il a fallu se poser, avoir une dimension de réflexion historique et critique sur notre art, ils l’ont très bien fait. Maintenant nous sommes vraiment dans une période post-déconstructionniste, cette Biennale en est le porte drapeau, mais tout ça était nécessaire. Et tous ces courants continuent de cohabiter.

Yoann Bourgeois
Ce qui est riche. C’est agréable pour le public d’avoir des propositions totalement différentes les unes des autres.
Voilà, les ludiques peuvent continuer à être ludiques, tout le monde est content qu’il y en ait encore, d’ailleurs Jean-Paul Montanari présente régulièrement Blanca Li. Les réfexifs ont des salles qui les programment et beaucoup de gens qui adorent leur travail. Il y a une danse qui vient du Moyen-Orient, d’Afrique etc. Tout ça s’est extrêmement diversifié et je n’ai absolument pas le sentiment que la danse soit sur le point de mourir.
Mais ce que Jean-Paul Montanari appelle la fin de la danse contemporaine, même si c’est à lui qu’il faudrait poser la question, c’est peut-être la fin de cette danse qu’on a appelée la nouvelle danse française, et ses suites. Peut-être que les évolutions dont vous parlez, pour lui, ne sont plus de la danse.
Le nouveau cirque n’est sans doute pas, pour lui, de la danse. Et c’est en partie vrai. Mais enfin Yoann Bourgeois a travaillé avec Maguy Marin pendant dix ans, Mathurin Bolze avec Joseph Nadj et François Verret. Ils se sont beaucoup formés grâce à la danse. Pour moi c’est une dimension, comme il y a eu la danse plasticienne, il y a la danse circassienne. Je pense qu’il est très important, et c’est ce que je fais à Lyon, de continuer au contraire à défendre la création et le développement de toutes ces hybridations, de toutes ces possibilités d’invention. Ce que j’aime chez Cecilia Bengolea et François Chaignaud, par exemple, c’est qu’ils continuent d’inventer. Ce qui serait très symptomatique, c’est qu’on soit tout à coup dans un académisme. Mais ce n’est pas ce qui se passe. Je pense qu’Olivier Dubois est en train de faire une très belle création. Il est dans une danse humaniste, profonde, exacerbée. Il n’est pas dans le repli, c’est tout l’inverse ! Il est dans une affirmation de la puissance du corps, de la question du corps aujourd’hui. Israel Galvàn, qui sera présent lors de cette Biennale, réinvente sa danse à chaque fois. Nous avons aussi ça, le flamenco contemporain. Voilà encore un nouveau registre qui est né après les années 1980 !

FLA.CO.MEN d’Israel Galvàn
Puisque nous évoquons les sujets qui fâchent… Lorsque j’ai interviewé Didier Deschamps à l’occasion de la fin de son premier mandat à la tête du Théâtre de Chaillot, je lui ai demandé s’il ne nourrissait aucun regret quant à sa candidature, écartée à votre profit, pour les Maison de la Danse et Biennale de Lyon. Il a répondu ne pas trouver le personnel politique à la hauteur dans votre ville, évoquant au titre de promesses non tenues le projet, finalement avorté, de la nouvelle Maison de la Danse dans le quartier Confluence. Comment vivez-vous la situation de votre côté ?
J’ai meilleur caractère (rires) ! Je suis une femme réaliste et enthousiaste. En effet il y avait le rêve d’un très grand lieu, un énorme projet de 100 millions d’euros à Confluence. Mais tous les partenaires se sont débinés, la ville certes, mais aussi l’Etat, et tous les autres. Finalement, le maire de Lyon a tenu sa promesse puisque je vais avoir un nouveau lieu. Il sera installé dans le musée Guimet. C’est un endroit très aimé des lyonnais, qui accueillait jusqu’en 2007 la collection Guimet, et une sorte de musée d’histoire naturelle et des civilisations. Un lieu patrimonial donc, qui va être réhabilité en atelier de la danse, avec une salle de 500 places et deux studios réservés à l’éducation artistique. C’est vrai qu’il m’a fallu être très patiente, ça ouvrira en 2020, mais ce lieu, j’en suis sûre, va finalement naître.
Le fait d’avoir des studios, un plateau plus petit va vous permettre de programmer des choses un peu différentes.
Oui. Là où Didier Deschamps a raison, c’est que j’avais été très claire avec la municipalité, leur disant que je ne viendrais à Lyon que s’il y avait un lieu de création. Evidemment, avec mon parcours de danseuse et de chorégraphe, ouvrir une vitrine où je verrais les artistes passer serait un contre-emploi, une erreur de casting. J’aime accompagner les jeunes compagnies, je suis proche d’eux. Ça a donc été discuté. Il manquait à Lyon de façon évidente, et même un peu aberrante, un foyer de création. Si on ajoute le nombre de spectateurs de la Maison de la Danse à ceux de la Biennale, on arrive à 250.000 personnes. Et puis il y a une pépinière, ceux qui sortent du Conservatoire, ceux qui sortent de l’Opéra, qui créent eux aussi pour certains. Il y a un terrain particulièrement favorable, nous n’avions juste pas d’endroit pour les accueillir. Donc en effet c’était long, mais en 2020 ce sera bon.

Auguri d’Olivier Dubois
Et de votre côté, même si de toute évidence il y a un aspect très créatif dans vos fonctions, danser, chorégraphier ne vous manque-t-il pas ?
Moi, comment dire ? J’aime bien tourner les pages, je suis une tourneuse de pages. J’ai arrêté de danser du jour au lendemain, à 40 ans, à New York. J’ai dit stop.
C’est vrai ? Vous n’avez plus dansé du tout depuis ?
Oui. Je n’ai rien fait depuis, rien, zéro, fini.
C’est étonnant !
Oui c’est bizarre, mais c’est comme ça. Ce qui m’intéresse ce sont les projets. Sans projet je serais terriblement malheureuse. Je préfère avoir un projet et ne plus danser que de continuer à danser sans projet. L’important est d’avoir un objectif, une dimension de développement, être en rapport avec le monde dans lequel on vit, tenter de donner des réponses aux sujets importants, aux enjeux de société, de culture, être auprès des artistes. La plus belle période de ma vie est celle où j’ai dansé, j’ai adoré ça. C’est peut-être pour ça que j’ai été si violente. Je ne voulais pas que l’on vienne me voir dans un état de décrépitude avancée (rires). J’ai préféré garder les bons souvenirs de moi qui danse, au top.
Et puis avoir dansé était un plaisir immense, mais la création est aussi une souffrance. Il y a les premières, l’évaluation permanente, on est jugé tout le temps. Quand on est danseur.se, on est là, on se lance, on vit, on est au top, et on pense beaucoup à soi aussi (rires). Alors que lorsqu’on est auteur.rice, le rapport à la critique, au public, au politique, est beaucoup plus complexe. C’est une exposition extrêmement forte, un doute de tous les jours. C’est un métier très dur. C’est pour ça que quand j’échange avec les chorégraphes je leur dit “détends-toi, j’étais à ta place il y a quelques années, on va passer la page 1, la page 2, le jargon obligatoire, et parler directement du travail“.
Ce travail d’accompagnement, de pédagogie, vous plait ?
Il y a une vraie jouissance à accompagner de jeunes artistes, à voir leurs mondes qui sont plus actuels. J’ai accompagné Cecilia Bengolea et François Chaignaud depuis le Théâtre de Chaillot, Yoann Bourgeois aussi, je suis très fan du travail d’Olivier Dubois. Il est très important que leurs œuvres aient la réception qu’elles méritent. Et je suis là pour ça, pour transmettre. De toutes façons je suis une pédagogue, même quand je dansais je passais mon temps à enseigner. C’est aussi un des plus beaux métiers du monde de transmettre, d’être généreux, d’être au service. Ils galèrent tous terriblement. Nous, nous étions quand même dans une belle période. J’ai eu un Centre Chorégraphique, le Théâtre de Chaillot, j’ai eu une belle vie d’artiste chorégraphique. Je vois ceux et celles qui ont tellement de talent et les difficultés qu’ils traversent. En étant au plus près d’eux je me sens très utile.

La programmation complète, les dates, horaires, informations pratiques et réservations pour tous les spectacles et toutes les animations sont à retrouver sur le site de la Biennale de la danse.


